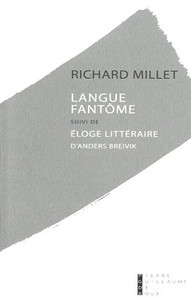Comment ne pas ouvrir ce dossier de Collateral sur la bataille culturelle de l’extrême droite sans commencer par évoquer, dans le sillage de l’affaire Tesson, la question de la littérature réactionnaire ? C’est en compagnie de Vincent Berthelier, auteur du riche Le Style réactionnaire : de Maurras à Houellebecq, paru chez Amsterdam qu’il s’agira ici d’évoquer comment se caractérise la réaction stylistique, et comment la droite française s’est signalée en littérature depuis Maurras. Mais peut-on, de Nimier jusqu’à Richard Millet et Renaud Camus, parler de bataille culturelle selon un vocabulaire emprunté à Gramsci ? L’extrême droite qui domine le moment politique que nous vivons caractérise-t-elle également le contemporain d’écriture que nous vivons ? Réponses en compagnie de l’essayiste le temps d’un grand entretien.
Ma première question voudrait porter sur la genèse de votre stimulant essai sur Le Style réactionnaire : de Maurras à Houellebecq paru chez Amsterdam. Est-ce qu’il y a un fait d’actualité ou une lecture en particulier qui ont pu nourrir chez vous le désir d’interroger « le style réactionnaire », à savoir tracer, comme vous le faites ici, l’histoire de la droite littéraire tout au long du 20e siècle ? Si votre ouvrage se clôt sur trois écrivains contemporains situés à l’extrême droite avec Renaud Camus, Richard Millet et Michel Houellebecq, est-ce que la présence centrale, notamment de Houellebecq, dans la vie médiatique a engagé chez vous la réflexion sur l’hégémonie culturelle que représente désormais la réaction dans les questions et le lexique du débat public en France ?
Sur les différents facteurs qui ont déterminé mon intérêt pour ce sujet, il y a eu en effet un événement d'actualité, désormais assez lointain : en 2013, un jeune militant antifasciste, qui se trouvait militer dans le même syndicat étudiant que moi-même si je ne le connaissais pas, a été assassiné par un groupe néonazi. S'est ensuivie une réflexion sur le fonctionnement de l'extrême-droite et du fascisme, qui ne pouvait pas être réduit à ce genre d'action violente, mais entamait depuis un moment une stratégie institutionnelle, où la culture et les représentations avaient de toute évidence un rôle à jouer. Ça, c'est devenu assez clair après les attentats de 2015 : je me souviens que dans le 5ᵉ arrondissement de Paris, où j'étudiais alors, on pouvait lire sur les murs divers graffitis islamophobes, dont « Houellebecq prophète » (mais aussi « Faites plus d'enfants, sinon c'est l'islamisation de la France », ce qui fait pour le coup écho à notre actualité récente). Quand on y réfléchit, c'est tout de même assez rare dans l'histoire littéraire qu'on accorde une telle place à un écrivain (ou des écrivains : le même usage est fait de Jean Raspail, rétrospectivement, et de Renaud Camus), et ce alors même que la littérature est plutôt un medium en déclin. Dans le genre, je ne vois guère qu'Orwell et Huxley comme prédécesseur.
Le troisième élément d'actualité qui a suscité mon intérêt vient de l'écologie. À l'époque, je lisais La Décroissance, revue d'écologie radicale produite par des gens issus de la gauche, mais qui devait se dépêtrer de l'étiquette de réactionnaire que le reste de la gauche lui accollait, parce que les décroissants étaient anti-PMA et GPA (mais pour tout le monde, pas juste pour les homos). Et ça, je crois que c'est moins révélateur de l'hégémonie culturelle supposée de l'extrême-droite que de l'incapacité croissante de la gauche à supporter la pluralité et l'impureté idéologiques en son sein.

Ce qui ne manque pas d’emblée de frapper dans votre réflexion, c’est combien la question du style réactionnaire ne répond pas d’un idéal-type mais répond d’évolutions même dans sa conception et son usage par la droite littéraire. Vous distinguez ainsi trois moments majeurs dans l’histoire de la littérature de droite au 20e siècle qui correspondent, selon vous, à trois moment distincts de la conception stylistique par les écrivains réactionnaires eux-mêmes : un classicisme nostalgique de l’Ancien régime pour Maurras ; un dandysme du style qui cultive une aristocratie faisant fi des règles d’usage avec Drieu La Rochelle notamment ou Roger Nimier encore ; enfin une réaction contemporaine qui vit dans l’horreur de ce qu’elle nomme notamment avec Millet la « post-littérature », avec ce sentiment d’arriver trop tard et de vouloir retrouver une langue pure, loin des barbares anglo-saxons notamment. Le point commun, dites-vous, entre ces trois strates historiques pourtant très différentes n’est pas à chercher dans la littérature mais dans la recherche d’une posture sociale, ce qu’avec Bourdieu vous pointez comme un souci de distinction.
Ma question sera la suivante : est-ce que cette volonté de distinction ne choisit pas avec privilège, notamment de nos jours, la littérature parce que la littérature est elle-même dévaluée dans le monde actuel, qu’elle a perdu de son aura et qu’elle constitue une marque pour eux de distinction culturelle contre une acculturation fantasmée que Richard Millet ou encore Renaud Camus déplorent ? Est-ce que la perte de la haute valeur sociale de la littérature n’est pas paradoxalement au cœur de la recherche de distinction de ces auteurs passéistes, épris de grandeur dévolue ?
Tout d'abord, si c'était le cas, ça ne le serait que pour la période contemporaine. La droite littéraire réactionnaire des années 1950, celle de Nimier que vous mentionnez, ne s'oppose pas à une supposée masse inculte, mais cherche à se distinguer de figures d'écrivains engagées à la Sartre, ou des nouveaux romanciers auxquels ils ne comprennent rien, mais en tout cas aux représentants d'une littérature qui a encore un prestige social considérable.
Aujourd'hui, c'est bien différent, en effet, et R. Camus ou R. Millet déplorent un monde où l'écrivain n'est plus une autorité linguistique, culturelle ou morale. Peut-on en dire autant de Houellebecq ? Il fait le constat qu'on n'attend plus d'un romancier contemporain ce qu'on attendait d'un Balzac ou d'un Dostoïevski, et pourtant, force est de constater qu'on le lit un peu comme un auteur du XIXe – alors qu'il ne fait pas de littérature documentaire, sociologique ou historique, ça reste essentiellement du roman d'imagination, à partir de matériau qui sont accessibles à tout le monde. Le paradoxe, c'est que la littérature soit encore capable de produire ce genre de figure d'autorité malgré son déclin social et symbolique incontestable (au profit d'autres objets culturels, bien sûr).
Un des points remarquables de votre réflexion consiste à souligner combien le style sert le plus souvent à produire des stylèmes, à savoir des marqueurs discursifs qui singularisant la prose de l’écrivain le rendent aisément reconnaissable. On a le sentiment que le style constitue pour certains des écrivains que vous étudiez une manière de s’imposer dans un champ qui n’appartient pas uniquement à la littérature : le style serait à considérer chez eux à la fois comme une monnaie de conversion et de mise en forme de l’idéologie en énoncés politiques mais aussi comme une monnaie d’échange pour occuper une place politique. Ainsi Renaud Camus glisse-t-il de la littérature à la politique, ce qui pose une question centrale : est-ce que la littérature n’est pas, dès le début, chez les réactionnaires un outil pour œuvrer à une carrière politique ? Y a-t-il un véritable souci littéraire ou la politique l’emporte-t-elle sur toute autre visée ?
On m'a justement reproché de voir des stratégies partout ! Or cette attitude stratégique opère chez certains (et il serait naïf de le nier, et d'ailleurs ce sont aussi des phénomènes qui s'observent à gauche) : Maurras ou Nimier ont une vision politique depuis le début. D'autres déploient des stratégies essentiellement littéraires, mais observables, et où la visibilité du style joue à plein : Jouhandeau, Morand, Millet. D'autres enfin ne séparent pas la politique du littéraire, mais sans stratégie ni calcul : à plusieurs moments, Bernanos semble se saborder complètement, et c'est ce qui est admirable chez lui. Mais ce à quoi je me suis efforcé dans tous les cas, c'est de faire sincèrement sa part à la création littéraire et langagière, y compris pour montrer à quel point elle pâtissait de l'enrégimentement idéologique de l'auteur. L'œuvre de Renaud Camus s'est fait tuer par la dérive politique de son auteur. D'autres œuvres, à l'inverse, ne survive que parce que la droite (ou une fascination malsaine pour la réaction) les maintient artificiellement en vie : les Hussards étaient des acteurs importants du monde littéraire des années 1950, mais leur œuvre est d'un intérêt très mince (et ils ne se le cachaient pas eux-mêmes). D'ailleurs, Le Figaro semble rêver de leur style de vie (champagne et bagnoles de sport) plus que de leur manière d'écrire.
Un autre aspect que vous mettez en lumière renvoie, dans le dernier temps de votre réflexion, à la fin de l’hégémonie de la Gauche, dont l’acmé se situe en 1968 et qui, avec le choc pétrolier de 1973, amorce son déclin pour laisser bientôt place à un néolibéralisme violent au tournant des années 1980 et l’émergence parallèlement d’une extrême droite française emmenée par Jean-Marie Le Pen. Progressivement, notamment dans les années 1990, « les idées de l’extrême droite s’insinuent en littérature », remarquez-vous avant de conclure, après notamment avoir cité les noms d’Alain Finkielkraut et Elisabeth Lévy : « A prendre ainsi le risque de se fondre dans la parole médiatique, il n’est pas certain que le style sorte vainqueur. » N’est-ce pas ainsi exagéré de parler ainsi de « style » pour caractériser notre littérature réactionnaire de notre temps, entre le non-style revendiqué de Houellebecq et la surstylisation affectée de Richard Millet ? Pourquoi ainsi ne pas avoir étudié les récits de Finkielkraut : jugez-vous ainsi que l’homme que Bourdieu qualifiait de « demi-savant » est un « demi-écrivain » qui joue un autre rôle dans la légitimation sociale de la réaction ?
Je ne connais pas les récits de Finkielkraut, et il me semble qu'ils n'ont pas retenu l'attention des lecteurs spécialisés (mais on peut se tromper !) ; quant à ses essais, qui empruntent à des formes d'écritures issues de l'institution scolaire et universitaire (la dissertation), ils ne relèvent pas à proprement parler de la littérature, quoiqu'ils jouent un rôle idéologique important en proposant une synthèse de l'universalisme et d'une pensée du déclin.
Toutefois, Finkielkraut a un style, comme toute personne qui écrit. Du point de vue de ma discipline, la stylistique, on peut distinguer des styles saillants et d'autres discrets, on peut porter sur eux les jugements de valeur qu'on voudra, mais le non-style, le style zéro, ça n'existe pas. Toute écriture présente un ensemble de caractéristiques linguistiques (lexicales, syntaxiques, énonciatives, etc.), qu'on peut décrire, distinguer ou au contraire raccrocher à des ensembles. C'est justement le caractère objectif de ces données linguistiques qui permet de mesurer l'écart entre les discours sur le style, qui guident et souvent biaisent la lecture, et les pratiques réelles.
Enfin ma dernière question rejoint celle qui préside à ce dossier prospectif : est-ce que l’extrême droite a gagné la bataille culturelle selon vous ? Est-ce que, précisément, la réaction que vous analysez ne choisit pas, plus qu’une autre tendance politique, la culture pour y mener une bataille ? Pour reprendre le questionnement qui est le vôtre en conclusion de votre propos : « le littéraire se réduit à être la caisse de résonance des débats idéologiques » ? Pour le dire en un mot : vivons-nous un moment littéraire ou un moment politique ?
Il est évident que nous vivons un moment politique (dans lequel le clivage droite-gauche a gardé toute sa pertinence, même si je déplore qu'il ne prenne plus pour centre de gravité la question de la démocratie), et toutes les polémiques littéraires récentes le prouvent.
Je ne sais pas trop ce que veut dire "bataille culturelle", et ce lexique gramscien dont j'ai tendance à me méfier. D'abord, on ne peut bien sûr pas limiter la question à la littérature. Ensuite, quel que soit le support, peut-on dire que l'extrême droite a réussi à produire (ou récupérer) des œuvres "nationales-populaires", comme dit Gramsci ? Bac Nord ? Vaincre ou mourir ? Rien de comparable au succès de Barbie, qui balaie un éventail idéologique allant de la droite néolibérale à la gauche radicale. Tesson ? ce n'est pas un militant, et il y a un gros pas à faire entre quête de transcendance et envie de fascisme. Houellebecq ? Peut-être, mais il y a quand même du monde en face... Je ne crois pas que ce soit sur le plan culturel qu'il faille d'abord s'inquiéter : les forces progressistes devraient plutôt avoir pour priorité de s'adresser à ceux qu'elles tiennent pour des incultes, en démocratisant leur recrutement et leur fonctionnement, et en se défaisant du gauchisme (l'obsession de la pureté idéologique).
Du côté des lettres, il nous reste il est vrai une double tâche : défendre notre camp (ce que mon livre essaie modestement de faire), et défendre la littérature tout court. Ça implique de réfléchir à ce qu'on transmet comme textes et à la manière de transmettre, de sauver le canon en l'amendant et l'adaptant aux lectrices (largement plus nombreuses que les lecteurs), de forger un panthéon mixte et internationaliste, sans céder à une militance stupide (il est absurde de surreprésenter la littérature haïtienne quand nos élèves n'ont jamais lu une ligne de littérature chinoise). Ce sont des tâches plutôt enthousiasmantes.

Vincent Berthelier, Le Style réactionnaire : de Maurras à Houellebecq, éditions Amsterdam, août 2022, 388 pages, 22 €